Alors que la réforme des retraites de 2023 semblait reculer l’âge d’accès à la retraite progressive, un nouveau geste gouvernemental en 2025 a fait renaître l’opportunité à partir de 60 ans. Ce dispositif, longtemps méconnu et peu sollicité, gagne en visibilité. Plus qu’un simple ajustement, cette mesure permet à des milliers de salariés de réduire leur temps de travail tout en percevant une part de leur pension de retraite. Mais ce mécanisme soulève plusieurs questions cruciales. Quels impacts sur le revenu immédiat ? La retraite définitive est-elle affectée ? Qu’en est-il des éventuelles démarches administratives et interactions avec les régimes complémentaires comme l’Agirc-Arrco ? Ce nouveau cadre invite à une réflexion approfondie pour s’orienter au mieux, notamment pour ceux approchant la retraite avec envie de moduler leur activité tout en optimisant leur avenir financier. Au cœur de ce débat, des interrogations concrètes émergent, impliquant Assurance Retraite, Pôle emploi, URSSAF et des acteurs tels que Malakoff Humanis ou La France Mutualiste.
Conditions clés et fonctionnement du nouveau dispositif de retraite progressive à 60 ans
Le retour de la retraite progressive dès 60 ans constitue un volet essentiel de la réforme que le gouvernement a revu avec soin. Ce dispositif est ouvert aux salariés du secteur privé comme aux agents publics, sous réserve de remplir certaines conditions d’éligibilité fixées par l’Assurance Retraite. La principale exigence est de justifier d’un minimum de 150 trimestres cotisés. Cette durée d’assurance est déterminante pour prétendre à ce mode de départ progressif. Par ailleurs, le salarié doit réduire son temps de travail, travaillé entre 40 % et 80 % d’un temps complet.
Le mécanisme consiste à cumuler un emploi à temps partiel et une fraction de la pension de retraite, une modalité qui offre un vrai pont entre fin d’activité et retraite complète. Concrètement, la personne ne cesse pas totalement son activité mais diminue ses horaires, ce qui a un impact direct sur son revenu mensuel, désormais constitué partiellement de salaire et partiellement de pension de retraite.
Voici les conditions détaillées à remplir :
- Avoir au moins 150 trimestres validés dans un régime de base relevant de l’Assurance Retraite
- Exercer une activité professionnelle à temps partiel comprise entre 40 % et 80 %
- Avoir atteint au moins l’âge de 60 ans, âge désormais confirmé comme seuil légal grâce au décret du 15 juillet 2025
- Faire la demande auprès des organismes : une seule démarche en ligne sur le portail Info-Retraite suffit pour gérer les droits auprès des différents régimes (régime de base et complémentaires Agirc-Arrco), bien que quelques exceptions transitoires persistent
Ce retour au seuil de 60 ans corrige la disposition antérieure qui portait ce seuil à 62, au titre de la réforme 2023. Il s’agit donc d’une avancée notable qui encourage les actifs proches de la soixantaine à envisager une transition plus douce vers la retraite complète. Le tableau suivant illustre l’évolution du seuil d’âge selon l’année de naissance :
| Année de naissance | Âge requis avant réforme | Âge requis au 1er septembre 2025 |
|---|---|---|
| 1946 | 61 ans | 60 ans |
| 1965 | 61 ans et 3 mois | 60 ans |
| 1966 | 61 ans et 6 mois | 60 ans |
| 1967 | 61 ans et 9 mois | 60 ans |
| 1968 | 62 ans | 60 ans |
Face à ce dispositif, les entreprises jouent aussi un rôle clé. Certaines, notamment via les ressources humaines ou les partenaires sociaux, peuvent accompagner leurs salariés pour un passage progressif. Par exemple, la Caisse d’Épargne et BNP Paribas ont d’ores et déjà mis en place des conventions internes favorisant ce type d’aménagement.
Enfin, malgré la simplification apportée par la plateforme unique, des situations spécifiques peuvent réclamer des démarches distinctes auprès de la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) et des régimes complémentaires Agirc-Arrco, sujet évoqué dans des guides détaillés comme celui du MoneyVox.
L’importance du temps partiel choisi
Le timing et la nature du temps partiel choisi sont fondamentaux. Le salarié peut opter pour une réduction de ses horaires, mais l’accord écrit de l’employeur est exigé. Cette condition d’accord permet aussi de négocier éventuellement des compensations ou des aménagements contractuels, comme un maintien partiel du salaire ou une prime de départ. Par exemple, des entreprises intégrant Malakoff Humanis dans leur plan d’épargne retraite complémentaire encouragent les plus anciens à franchir ce cap en douceur.
- Le temps partiel minimal doit représenter 40 % d’une activité complète.
- Le maximum fixé est fixé à 80 %, laissant une plage importante de manœuvre aux salariés.
- Dans certains métiers à forte pénibilité, une flexibilité encore plus adaptée est possible.
- Le choix volontaire de travailler à temps partiel permet aussi de limiter, voire d’éviter, des réductions automatiques sur les droits à pension dans le régime complémentaire.
Diminution des revenus à court terme : évaluer les impacts financiers
La question centrale pour nombre de salariés qui s’interrogent sur la retraite progressive à 60 ans concerne la baisse de revenus immédiate. En réduisant son temps de travail, le revenu salarial diminue naturellement. Une part de cette perte est compensée par une fraction de la pension de retraite versée concomitamment. Toutefois, ce cumul partiel peut ne pas toujours atteindre le niveau du salaire antérieur, ce qui appelle à une gestion attentive.
Le mécanisme d’évaluation implique plusieurs critères :
- Le taux de réduction du temps de travail — plus la réduction est importante, plus la perte salariale est sensible.
- Le montant de la pension progressive attribuée, calculée au prorata du temps travaillé
- Les éventuelles primes ou avantages liés à l’entreprise, qui peuvent être impactés
- Les possibilités de surcotisations pour compenser une retraite future amoindrie
Il convient d’envisager l’exemple de Claire, 61 ans, employée dans une grande mutuelle comme Mutuelle Générale. Ayant choisi de réduire son activité à 60 % du temps complet, elle constate que son salaire baisse de façon importante. En parallèle, sa retraite progressive lui procure un revenu complémentaire, toutefois inférieur au tiers de ce qui était perçu auparavant. Cela demande donc un ajustement du budget personnel, dans l’attente de la retraite définitive.
Une autre illustration concerne Paul, cadre bancaire au sein d’une grande banque, qui a opté pour la retraite progressive à 50 % d’activité. Son conseil financier l’a orienté vers une surcotisation volontaire, avec l’appui du service RH. Grâce à cela, il limite la baisse de sa future pension Agirc-Arrco, mais ses ressources nettes mensuelles conservent un écart avec son salaire précédemment intégral. Cette démarche surcotisations est une solution préconisée par le Ministère du Travail et les organismes comme la CNAV pour pallier la diminution.
| Situation | Taux temps partiel | Impact sur salaire mensuel | Complément retraite progressive | Résultat net prévisionnel |
|---|---|---|---|---|
| Claire (Mutuelle Générale) | 60 % | -40 % | + environ 30 % du salaire précédent | Perte nette de 10 % |
| Paul (Banque) | 50 % | -50 % | + 40 % (avec surcotisation) | Perte nette de 10 % également |
Cette notion d’équilibre financier doit être abordée avec attention avant toute décision, en utilisant notamment le simulateur officiel disponible sur Info-Retraite.fr. Il est crucial de vérifier les montants estimés en fonction de son profil personnalisé.
Impact social et fiscal de la retraite progressive
La baisse de revenus induite par la retraite progressive a aussi des conséquences fiscales qu’il convient de connaître. La question des indemnités de départ versées par l’employeur est un point d’attention. Selon les conditions du départ, certaines indemnités bénéficient d’une exonération ou d’un traitement fiscal spécifique, notamment lorsque l’indemnité est liée à une cessation progressive d’activité. Les salariés qui perçoivent ces indemnités doivent savoir comment elles s’intègrent dans leur déclaration fiscale, dans le cadre du régime général de l’impôt sur le revenu.
La complexité est accrue lorsqu’il faut définir l’imposition des indemnités en fonction du motif (départ à la retraite, licenciement, rupture conventionnelle, etc.). Le contexte législatif de 2025 rappelle que certaines indemnités peuvent être partiellement exonérées, mais les règles sont strictes et requièrent parfois des démarches précises. Pour approfondir, des ressources disponibles sur impots.gouv.fr et Paie-RH.com sont recommandées.
Comment gérer les dossiers de retraite progressive et retraite complète ?
Un aspect souvent source d’interrogations concerne les formalités administratives. La retraite progressive ne dispense pas d’effectuer une demande ultérieure pour la retraite définitive. Le système demande donc un double engagement en termes de dossiers, ce qui inquiète certains assurés.
En effet, lors du passage en retraite progressive, le salarié ouvre une couche de droits par cette formule temporaire. Au moment où il décide de cesser son activité totalement, il doit constituer un nouveau dossier spécifique pour la liquidation complète de ses droits. Cette réalité est confirmée par la Cnav et figure dans leurs recommandations officielles. Même si certains documents sont pré-remplis, un réexamen du dossier s’impose car les droits acquis pendant la période progressive s’ajoutent à ceux déjà validés antérieurement.
Voici les points essentiels à connaître :
- Demander la retraite progressive via le site de l’Assurance Retraite, en optant pour une démarche en ligne simplifiée.
- Obligation de déposer un nouveau dossier plusieurs années plus tard pour la liquidation complète.
- Le nouveau dossier est plus simple à remplir, mais nécessite une mise à jour des ressources et droits.
- En cas d’activité multiple ou d’adhésion à différents régimes, il faudra vérifier la compatibilité des documents.
- Le portail Info-Retraite centralise désormais les démarches, évitant de compléter dossiers à la fois auprès de la Carsat et de l’Agirc-Arrco, sauf cas transitoires.
Pour bien comprendre la procédure, le site MaîtriserSonBudget.fr offre un guide clair et complet, reprenant les vues des experts de l’Assurance Retraite.
Le cas particulier du cumul d’activités pendant la retraite progressive
Cette situation soulève des questions d’ordre pratique. Il est important de noter que la retraite progressive exclut le cumul avec une allocation chômage : Pôle emploi ne verse pas d’indemnité si le salarié réduit son activité pour bénéficier de ce dispositif. Aussi, il est interdit de cumuler retraite progressive et une autre activité salariée parallèle dépassant le seuil légal de 80 % d’un temps complet, sous peine de perdre son droit à la retraite progressive.
En cas de cumul emploi-retraite, il est donc fondamental de respecter scrupuleusement les limites posées par le Ministère du Travail pour ne pas entraîner une suspension du versement des pensions. Ce cadre strict vise à garantir la légitimité et la pérennité du dispositif, avec le support actif des organismes comme URSSAF et Malakoff Humanis qui veillent au bon respect des règles.
Le calcul et l’impact des pensions complémentaires Agirc-Arrco dans la retraite progressive
La retraite progressive implique également la mobilisation des droits dans les régimes complémentaires. Pour les salariés cadres et non-cadres relevant de l’Agirc-Arrco, les règles spécifiques s’appliquent. En effet, la complémentaire fonctionne par accumulation de points, le temps partiel impactant directement le nombre de points obtenus.
Le revers de la médaille est donc que moins de cotisations génèrent moins de points, ce qui peut réduire la retraite finale. Pour pallier cela, plusieurs options existent :
- Surcotisation volontaire : Elle permet de cotiser comme à temps plein, bien que la personne travaille à temps partiel. Cette solution demande un accord avec l’employeur et peut être accompagnée par des dispositifs internes d’entreprise et partenaires comme La France Mutualiste.
- Simulation préalable obligatoire : Avant de s’engager, mieux vaut utiliser le simulateur officiel de l’Agirc-Arrco, régulièrement mis à jour.
- Vérification des points acquis : Durant la retraite progressive, il convient de suivre régulièrement ses relevés pour éviter toute mauvaise surprise.
Une attention particulière est portée au calcul de la prime de départ en retraite, soumise aux règles propres à chaque convention collective. Certaines conventions, notamment dans le secteur bancaire, prévoient un calcul spécifique qui intègre le temps plein théorique et non la réalité du temps partiel. Ce dispositif constitue un avantage précieux pour ceux en retraite progressive, à l’image de l’exemple transmis par Neovia Retraite.
| Élément | Effet sur pension Agirc-Arrco | Solution |
|---|---|---|
| Travail à temps partiel | Moins de points accumulés | Surcotisation volontaire |
| Prime de départ à la retraite | Calcul basé sur salaire temps plein (selon convention) | Nécessité de vérifier les clauses conventionnelles |
| Relevé de carrière | Suivi régulier requis | Utilisation des simulateurs avec accompagnement RH |
Ce volet complémentaire complète ainsi l’action des organismes principaux d’Etat mais aussi des acteurs privés intervenant dans la gestion retraite, tels que Malakoff Humanis ou La France Mutualiste, dont les recommandations sont précieuses pour assurer une transition sereine et financièrement optimisée.
Indemnités de départ à la retraite progressive : aspects juridiques et implications fiscales
Le sujet des indemnités versées lors d’un passage vers la retraite progressive est souvent source d’incompréhensions. Ces indemnités dépendent en premier lieu du droit du travail et de la politique propre à chaque entreprise. Le Ministère du Travail rappelle que l’indemnité de départ à la retraite peut être exonérée d’impôts sous certaines conditions, notamment si elle respecte les plafonds légaux déterminés par la Caisse d’Épargne ou Malakoff Humanis, impliqués fréquemment dans ces opérations.
Il est essentiel de bien distinguer :
- Les indemnités spécifiques à la rupture du contrat de travail, qui varient selon le motif : mise à la retraite, départ volontaire, licenciement
- Les indemnités liées à la retraite progressive, qui peuvent être calculées au prorata du temps de travail restant
- Les mécanismes propres au régime conventionnel dont relève le salarié
Dans certains cas, la fiscalité appliquée sur ces indemnités est allégée, notamment lorsqu’elles s’inscrivent dans un cadre social sécurisé. Par exemple, Net-Entreprises détaille les formalités déclaratives nécessaires. La complexité reste néanmoins élevée, impliquant souvent l’intervention d’experts en paie ou conseils financiers spécialisés.
En outre, les salariés ont tout intérêt à maîtriser les détails imposables sur leur déclaration de revenus, respectivement auprès des plateformes dédiées de l’URSSAF et des services fiscaux. La bonne gestion de ces revenus annexes contribue à éviter les mauvaises surprises fiscales lors du calcul de l’impôt sur le revenu.
- Examiner le barème fixé et les plafonds exonérés
- Interroger les conventions collectives de son entreprise et les contrats d’assurance retraite
- Disposer d’un accompagnement personnalisé des experts de la Mutuelle Générale ou La France Mutualiste
- Mieux anticiper l’impact sur la fiscalité personnelle grâce aux simulateurs de l’Assurance Retraite
Pour approfondir ces questions, il est recommandé de consulter des guides spécialisés ou sites institutionnels comme impotsurlerevenu.org ou le portail retraite.com.
Anticiper la retraite progressive à 60 ans : conseils pratiques et outils pour réussir sa transition
Face au retour encourageant de la retraite progressive dès 60 ans, il est aujourd’hui crucial de bien se préparer. La coordination avec l’employeur, l’anticipation financière et l’usage d’outils adaptés constituent des clés importantes pour optimiser cette période transitoire.
Les conseils à suivre sont nombreux :
- Évaluer précisément ses droits acquis en consultant son relevé de carrière auprès de l’Assurance Retraite et Agirc-Arrco régulièrement
- Simuler les différents scénarios avec les outils recommandés par MaîtriserSonBudget.fr ou le portail Info-Retraite
- Anticiper l’impact financier en analysant les effets du temps partiel sur le revenu global et les futures pensions
- Discuter avec le service RH de son entreprise, notamment si elle propose des possibilités de surcotisation ou des primes spécifiques
- Se renseigner sur la fiscalité et les indemnités pour maîtriser l’effet sur les impôts et la trésorerie personnelle
- Prendre en compte ses projets personnels : temps pour s’investir dans du bénévolat, s’occuper de ses petits-enfants, ou encore réduire fatigue et stress
Les banques telles que BNP Paribas ou la Caisse d’Épargne peuvent également soutenir ce projet en proposant des solutions de gestion de patrimoine adaptées à la retraite progressive, incluant des placements ISR ou des assurances vie personnalisées. De même, Malakoff Humanis restaure ses services de conseil retraite pour accompagner au mieux les assurés.
Investir dans une approche globale garantit une transition vers la retraite plus harmonieuse et sécurisée, construite sur une base solide d’information et d’accompagnement. Ainsi, la retraite progressive à 60 ans apparaît non seulement comme une opportunité financière, mais aussi comme un levier d’équilibre personnel et professionnel.

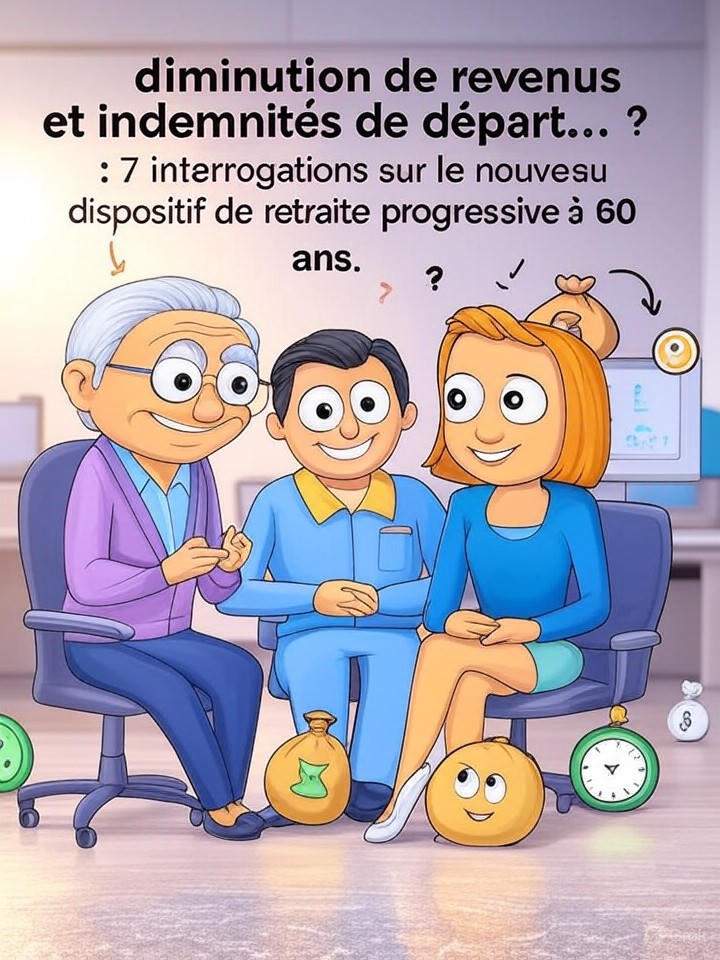



0 commentaires